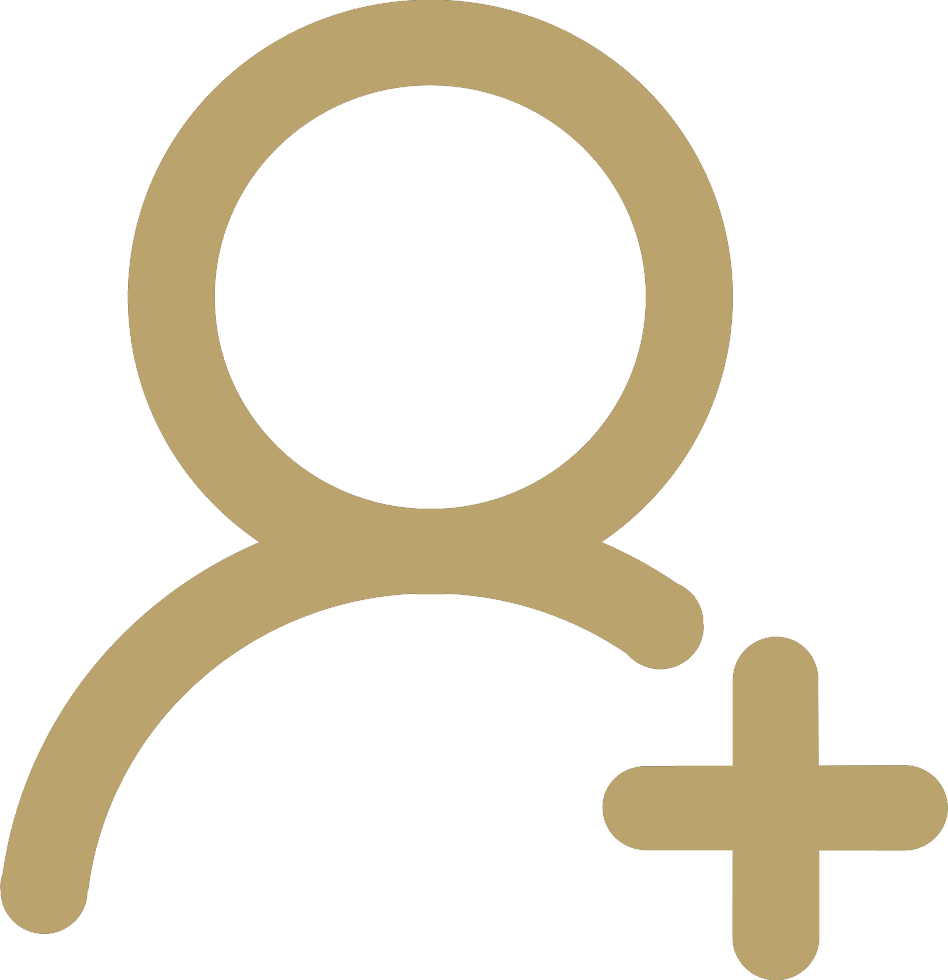Nathalie Heinich, sociologue chercheur au CNRS
Je commencerai par quelques réflexions basiques de sociologie des professions, et je terminerai par des éléments qui relèvent plus de l'expertise et du conseil que de la recherche proprement dite.
Rappelons ce qu'est une profession. Ce terme a deux sens en sociologie. Tout d'abord, il peut désigner une activité qui s'exerce contre rémunération, par opposition à une pratique amateur : c'est en ce sens qu'on peut parler, par exemple, de « professionnalisation » de l'écriture et, plus généralement, de tout ce qui relevait traditionnellement des « arts libéraux » (notamment la littérature et la musique) par opposition aux « arts mécaniques » (notamment la peinture et la sculpture) qui, eux, étaient essentiellement des activités rémunérées.
Par ailleurs, « profession » peut s'opposer non plus à amateurisme, mais à métier, d'une part, et à vocation, d'autre part. L'exercice d'une activité rémunérée peut en effet s'exercer selon trois régimes : le régime artisanal du métier, le régime professionnel et le régime vocationnel. La musique et la littérature, relevant jusqu'à l'art classique des « arts libéraux » n'étaient pas assimilables à un travail manuel, à la différence des arts mécaniques ; du même coup, elles ne sont que très métaphoriquement assimilables à de l'artisanat. Quand on dit que la littérature est un métier, en fait, c'est un petit déplacement : normalement on devrait dire une profession.
Depuis l'âge classique, musique et littérature ont en commun d'osciller essentiellement entre le régime professionnel et le régime vocationnel. L'activité vocationnelle - celle qui régit peinture, littérature et musique depuis l'époque romantique - ne s'exerce pas pour de l'argent mais par une « nécessité intérieure » de l'auteur, et n'est donc pas soumise à des rémunérations standardisées. Elle n'est pas obligatoirement encadrée par des institutions, n'est guère enseignée sinon peu enseignable, ne relève pas d'un diplôme ni de règles formalisées, et dépend essentiellement du talent individuel. On comprend mieux ce qui oppose ces deux régimes, professionnel et vocationnel, si l'on précise que le régime professionnel est celui de l'économie qu'on pourrait dire « normale », où l'on travaille pour gagner sa vie, alors que le régime vocationnel est celui de ce que Bourdieu appelait une « économie inversée », où l'on gagne de l'argent pour pouvoir exercer librement son besoin de créer. C'est exactement ce que vient de décrire Belinda Cannone.
Dans ce contexte, l'éventualité de tirer des profits de son activité n'est précisément qu'une éventualité, d'autant plus probable que le talent est certain mais aussi d'autant plus tardive qu'il s'agit d'un talent novateur, susceptible de passer à la postérité. Le grand nombre de lecteurs à court terme signale plutôt la conformité à une demande pré-établie et hétéronome, c'est-à-dire non spécifique des valeurs proprement
littéraires, alors que le petit nombre de lecteurs à court terme peut être - mais sans certitude - la promesse d'un grand nombre de lecteurs à long terme, parce que l'oeuvre en question aura su inventer non seulement de nouvelles façons de créer, mais aussi de nouvelles attentes du public potentiel à l'égard de la création. On peut dire d'une certaine manière que les grands écrivains sont ceux qui ont su créer une demande adaptée à leurs oeuvres novatrices et non pas s'adapter eux-mêmes à une demande préexistante.
Prenons un exemple, au XIXe siècle, de cette oscillation perpétuelle entre le pôle de la vocation et le pôle de la profession. On voit comment s'est mise en place la hiérarchie des genres littéraires entre ces deux pôles, puisque, au plus bas niveau de la hiérarchie, on a ce qui correspond au pôle professionnel, c'est-à-dire le journalisme et, à l'opposé, au plus haut niveau de la hiérarchie, on a le pôle vocationnel, avec la poésie et la tragédie, qui sont considérés comme extrêmement prestigieux mais très peu rémunérateurs. Du journalisme, on passe au roman qui, à l'époque de Balzac, était considéré comme un genre mineur destiné essentiellement à rapporter de l'argent. Et après le roman, et avant la poésie, on a le théâtre comique ou dramatique.
On voit d'ailleurs comment Balzac, dans Illusions perdues, dresse une sorte de sociologie, tout à fait remarquable, du déplacement dans cette hiérarchie des genres : Lucien de Rubenpré part du sommet, qui est le pôle vocationnel de la poésie, puisqu'il veut devenir un grand poète ; mais il se compromet pour s'intégrer, non pas au monde littéraire mais au monde aristocratique, et en se compromettant, il dégringole chacun des genres pour finir journaliste, tout en échouant dans son rêve d'intégration à l'élite parisienne. C'est une magnifique sociologie des genres littéraires.
Donc, dans ce contexte, écrire et gagner sa vie relèvent de logiques hétérogènes. Cela ne signifie pas qu'elles sont forcément contradictoires - il arrive qu'on puisse vivre de sa plume - mais elles sont non concomitantes : l'une n'est pas la garantie de l'autre, d'autant moins que l'auteur emprunte des voies singulières, non encore frayées par la tradition. C'est-à-dire ce que j'appelle le «régime de singularité», qui gouverne la création à l'époque moderne, à l'inverse du «régime de communauté», qui gouverne les activités ordinaires.
C'est pourquoi tout auteur - à moins d'être un rentier, ce qui était le cas le plus fréquent au XIXe siècle mais qui est devenu très exceptionnel - ne peut gérer cette situation que par des compromis, plus ou moins vivables, plus ou moins honorables, plus ou moins satisfaisants, et impliquant toujours un sacrifice. C'est le sacrifice de l'oeuvre pour le romancier à succès, qui se conforme au goût du grand public afin de s'assurer une rentabilité immédiate ; c'est le sacrifice de la personne, pour le poète maudit qui se résigne à vivre dans la misère pour se consacrer entièrement à son art sans aucune concession ; c'est le sacrifice de l'indépendance, pour l'écrivain patenté qui vit de bourses et de subventions diverses, préférant dépendre des commissions d'État pour moins risquer de compromettre son art et moins payer de sa personne ; c'est le sacrifice de la pureté, pour l'homme de lettres qui consacre une grande part de son temps à exercer des positions de pouvoir dans le monde littéraire, par exemple directeur de collection, critique, etc. ; enfin, c'est le sacrifice du temps, pour celui qui exerce un second métier - souvent celui d'enseignant - afin de pouvoir mener de front une vie sociale et familiale à peu près normale et une activité de création qui, cependant, dans son emploi du temps, sera forcément réduite à une portion minime ; c'est ce que vient de décrire Belinda Cannone. Je décris ces différents cas de figure dans mon livre Être écrivain, issu d'une enquête que j'avais réalisée à la demande du CNL il y a une quinzaine d'années.
Je vais maintenant enchaîner avec quelques suggestions à l'intention des auteurs. Elles sont une conséquence immédiate de ces données sociologiques et historiques que je viens de rappeler, mais je vais vous demander de me lire non plus comme un chercheur, qui décrit et qui analyse, mais plutôt comme un expert, qui prescrit ou, en tout cas, qui conseille.
L'alternative entre vocation et profession se pose aujourd'hui de façon cruciale et urgente pour de nombreux écrivains ou aspirants écrivains, qui n'ont pas la ressource du regard sociologique ni, souvent, la ressource d'une familiarité suffisante avec le monde littéraire pour en comprendre les règles. On entend souvent énoncer la revendication de vivre de sa plume comme une aspiration normale, qui irait de soi. Or cette aspiration ne va de soi que dans les activités ordinaires, de type professionnel, où l'on gagne à proportion de ce que l'on vaut ou que l'on est censé valoir sur un marché du travail relativement standardisé.
Mais plus on s'approche d'une définition vocationnelle, c'est-à-dire d'une aspiration à la littérature pure - définie de façon autonome et non pas hétéronome, pour reprendre le vocabulaire de Bourdieu, ou encore constituée selon les normes du régime de singularité et non plus du régime de communauté -, plus la rémunération est différée. En d'autres termes, on peut être un « auteur », au sens quasi juridique de quelqu'un qui publie des livres, et ne pas être considéré pour autant comme un « écrivain », au sens plus restrictif où, par la qualité de sa création, on pourrait espérer tenir un jour sa place dans l'histoire littéraire. Entre l'auteur d'ouvrages pratiques mais aussi de livres scientifiques, de traités juridiques, etc., et l'écrivain attaché à produire une oeuvre véritable, il y a toute la distance entre le pôle professionnel est le pôle vocationnel de l'activité d'écriture.
On ne peut donc logiquement vivre de sa plume qu'à deux conditions : soit en privilégiant le statut d'auteur sur celui d'écrivain, et en choisissant délibérément de consacrer une partie de son talent d'écriture à des activités littérairement mineures, voire carrément mercenaires, des travaux de commande, des écrits de circonstance, des genres populaires ; soit en exigeant des pouvoirs publics qu'ils compensent les carences du marché face à la création en pensionnant, sous une forme ou sous une autre, les écrivains. Or cette seconde solution, qui est réclamée par certains sous une forme quasi syndicale, pose des problèmes non seulement pratiques - car comment sélectionner les bénéficiaires, puisque tout le monde ne peut être payé pour écrire sans risquer de vider rapidement les caisses de l'État - mais aussi éthiques. En effet, payer des gens pour être ce qu'ils sont - écrivains - et non pour ce qu'ils font - des livres - reviendrait à rétablir les privilèges d'Ancien Régime octroyés aux aristocrates : une éventualité peu défendable en régime démocratique.
Le sociologue ici ne peut donc que conseiller aux auteurs ou aux écrivains de prendre en compte la spécificité du régime vocationnel, c'est à-dire de ne pas considérer l'écriture comme une source de revenu. Qu'elle le devienne est une éventualité sans doute désirable, mais nullement obligatoire ni due par la collectivité. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer à toute rémunération liée à la création. Ce qui est pris par des lecteurs, acheté en librairie après avoir été publié par un éditeur, entre dans une transaction entre offre et demande, c'est-à dire dans un marché, et appelle de ce fait un traitement marchand, c'est-à-dire une rémunération. Mais cela concerne l'aval de la publication, et non pas l'amont. Tant qu'il ne se concrétise pas dans des oeuvres susceptibles d'intéresser autrui, le besoin ou le plaisir de créer relève d'une nécessité individuelle, non d'une logique collective et encore moins marchande.
Bref, on peut vivre de sa plume, certes, à certaines conditions, mais cela n'implique pas qu'on le doive. On économiserait sans doute beaucoup d'espoirs déçus et d'aigres ressentiments si cela était mieux compris, notamment par des aspirants écrivains issus de milieux peu familiers au monde artistique, et qui tendent du même coup à y importer une logique pas toujours appropriée à ce monde.