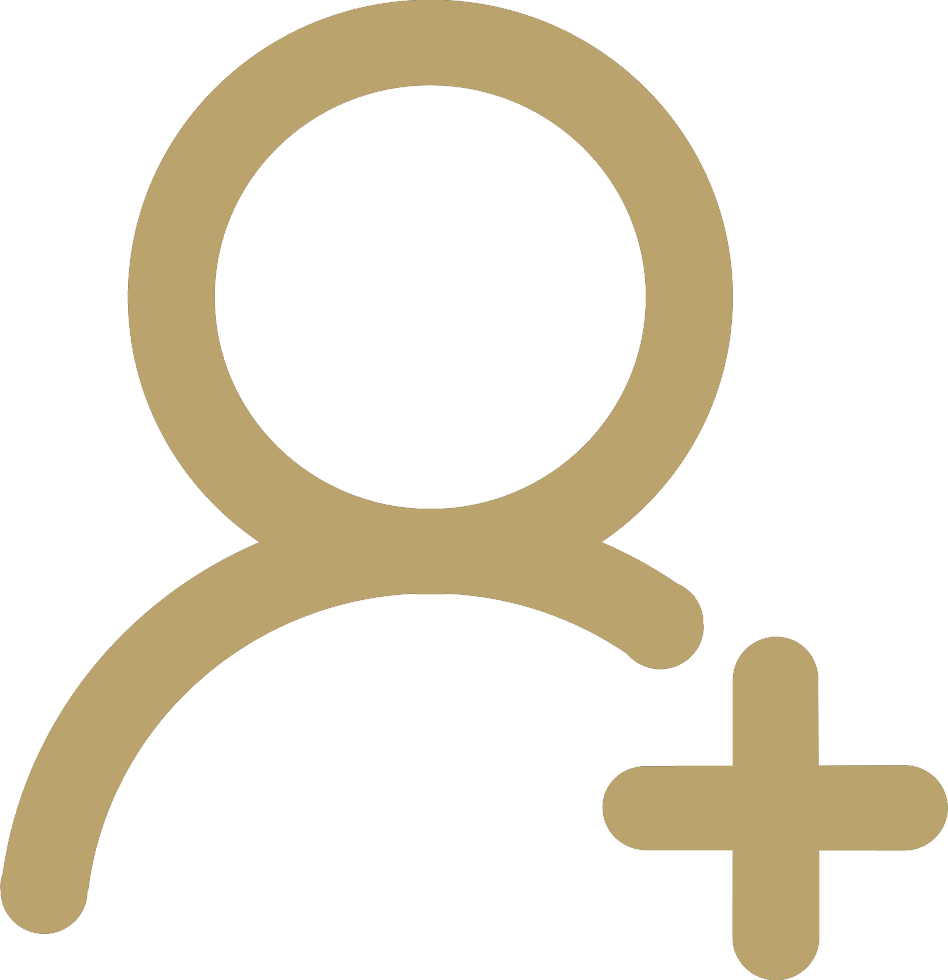Table ronde modérée par Jean-Guy Boin
Je remercie la SGDL d’avoir organisé cette rencontre. Je me réjouis de ne pas avoir eu à parler de la mondialisation dans la traduction : les notions de géographie et de géopolitique de la traduction me paraissent scientifiquement plus solides.
Participent à cette table ronde des personnes qui nous parlerons de quatre zones linguistiques. Il y a deux Français et deux non-Français ; deux éditeurs, Timothy Bent et Ana Estevan, un ancien diplomate devenu universitaire, Richard Jacquemond, et un ancien universitaire devenu diplomate, Nicolas Idier, attaché culturel à l’ambassade de France à Pékin.
Les statistiques sont particulièrement difficiles à manier dans les industries culturelles car le déclaratif ne correspond pas toujours à la réalité des données statistiques. Bien que les chiffres soient souvent biaisés, nous essayons d’avancer sur ce sujet en améliorant la collecte des données des éditeurs en matière de traduction.. Je m’appuierai ici sur les statistiques dont nous disposons en établissant une comparaison entre 2000 et 2010 pour les quatre zones linguistiques concernées.
Une étude menée par le Syndicat national de l’édition et le BIEF indique que les cessions de droits d’auteur ont porté sur 9 478 titres. Ce chiffre est inférieur à la réalité car nous ne disposons pas d’un déclaratif total : on est en fait un peu au-delà de 10 000. En 2000, 5 947 titres étaient concernés. Malgré les variations de périmètre, l’évolution est nette et correspond à ce que vient de décrire Gisèle Sapiro.
Concernant l’anglais, 573 titres ont été cédés en 2010 contre 463 il y a dix ans, dont 265 vers l’américain contre 181. Cette progression était inattendue : comme quoi on s’auto-intoxique avec des idées reçues !
Concernant la langue espagnole, 936 titres ont été cédés contre 704 en 2000, dont 702 vers l’Espagne contre 600. Cela corrobore le propos de Gisèle Sapiro sur les territoires centraux par rapport à la périphérie.
Concernant la langue chinoise, les cessions concernent 909 titres contre 343, dont, pour la seule Chine, 744 contre 244.
Concernant l’arabe, 155 titres ont été cédés contre 42, dont 53 pour le Liban, 38 pour l’Égypte, 21 pour l’Algérie et 8 pour les Émirats arabes unis.
Les participants à cette table ronde représentent donc, d’une certaine façon, 30 % des achats de droits de livres français. Je leur ai proposé de préparer pour cette table ronde une intervention préalable apportant des éléments sur le sujet traité.
Après être passé par différentes maisons d’édition, Timothy Bent travaille actuellement chez Oxford University Press. Il est également le traducteur de plusieurs ouvrages français.
Timothy Bent
Je remercie la SGDL pour son invitation. C’est un grand plaisir pour moi de revenir à Paris après plusieurs années. Le texte de mon intervention, je préfère vous en avertir, est enregistré sur mon Kindle à 10 dollars. Je commencerai par un aperçu de ma propre géographie éditoriale. Le terme de « maison » d’édition comprend l’idée de lieu, de cadre. Il se trouve que celle où je travaille s’inscrit spécifiquement et irréfutablement, pour le meilleur et pour le pire concernant les livres qu’elle publie, dans un lieu : Oxford, qui porte le poids de sa géographie. Pour dire les choses de façon plus commerciale, Oxford est une marque, un label Mon travail d’éditeur consiste notamment à me servir sans scrupule de cette marque comme levier d’acquisition. Publiez chez Oxford, dis-je aux auteurs, et vous vous verrez conférer le prestige et le pouvoir de l’imprimatur universitaire.
Oxford, je le sais, est loin d’être unique mais l’association du lieu et du nom reste néanmoins forte, en tout cas plus forte que pour toutes les autres maisons d’édition où j’ai travaillé – Penguin, Little Brown, Harcourt, St. Martin’s Press. De temps en temps, elle peut même s’avérer intimidante, sinon paralysante. Qui plus est, l’identité « Oxford », est indéniablement dépendante de la langue anglaise, sachant que, quasiment depuis leurs débuts, les Presses universitaires d’Oxford se sont assigné la tâche monumentale de faire figure d’autorité ultime pour tout ce qui touche à la langue anglaise, en identifiant, triant, catégorisant de manière exhaustive les éléments constituants du langage. Partant de là, le pas est vite franchi de se considérer comme le gardien officiel de la langue anglaise grâce à une seule et même gigantesque référence : le Oxford English Dictionary.
Si j’évoque tout cela, c’est parce que cela montre quels sont, pour moi, les défis et les questions posés spécifiquement par la traduction. La langue anglaise peut être considérée, à juste titre, comme une langue bâtarde, un mélange hybride de langues romanes et de plusieurs dialectes bas-néerlandais antiques, mais l’anglais d’Oxford a contribué à faire de cette langue une institution. Dans mon cas, les choses se compliquent encore par le fait que je travaille pour le bureau américain de cette institution très vénérablement britannique, entouré non par des étudiants et par des professeurs, mais par Macy’s Department Store et l’Empire State Building, cette icône explicitement américaine du consumérisme et de l’hégémonie des marchés.
Pour le dire autrement, la branche américaine d’Oxford représente une certaine forme de traduction : la transplantation d’un type particulier de géographie dans un autre. Jusqu’à un certain point, cela accentue les qualités instinctives : isolationnisme et auto-investissement américains d’un côté, britannicité la plus pure de l’autre. Ce n’est pas l’atmosphère la plus accueillante ni le sol le plus fertile pour la traduction. Ajoutez à cela qu’Oxford ne publie pas – et que par voie de conséquence je n’achète pas – de fiction : les chances données à la traduction sont diminuées d’autant.
Ce que l’on appelle en anglais non-fiction, et que l’on peut traduire en français par « essais », n’est après tout qu’une question de géographie de l’auteur : « D’où écrit-il ? ». La première question que je me pose avant d’acquérir un nouveau projet est de savoir d’où vient son auteur. C’est ma façon d’appréhender la géographie de la traduction : la traduction relie deux géographies, linguistiques ou autres, celle de ses origines et celle de la culture dans laquelle elle est introduite. La réussite de la transplantation dépend de tellement d’éléments !
Je prendrai quelques exemples de transplantations couronnées de succès en ce moment aux États-Unis. Le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, se vend mieux aux États-Unis que tout autre essai traduit ces dernières années, probablement depuis La Vie sexuelle de Catherine M. Cela prouve que les essais français qui véhiculent soit du sexe, soit de l’indignation (« J’accuse ! ») gardent une chance d’entrer sur le marché américain. D’une certaine manière, ceux-là n’ont pas besoin d’être traduits.
Mon sentiment est que le succès de Hessel tient d’abord à son histoire personnelle – Résistance, camps de concentration – qui lui confère une autorité indéniable. D’autre part, il y a l’air du temps, le Zeitgeist, le parfum de la révolte qui a changé le Moyen-Orient et qui s’est répandu jusque dans Wall Street. Le livre s’est greffé, à mon avis, sur le sentiment généralisé que le centre ne tient plus, que nous avons perdu tous nos repères moraux : le temps d’agir est venu. La troisième raison de son succès est auto-explicative : par le titre, on comprend immédiatement de quoi il s’agit ; inutile de traduire, l’appel est universel. Enfin, il s’agit somme toute d’un manuel de développement personnel, genre apprécié des Américains (« Lisez ce livre, il va changer votre vie ! Vous formerez un nouveau noyau de résistance ! »).
En fiction, il y a L’Élégance du hérisson de Muriel Barbery. Il s’agit d’un roman, genre pour lequel la géographie de l’auteur importe moins, voire pas du tout, contrairement aux essais où il est souvent préférable de venir d’un ailleurs complètement nouveau – terra incognita : frenchness, portugueseness, spanishness... Ce qui importe pour le roman, c’est la géographie dans laquelle il prend place et la capacité de l’auteur à donner le sentiment de lieu, à créer ou à recréer une géographie.
Dans une certaine mesure, cette analyse est également applicable à Suite française, d’Irène Némirovsky, qui a connu un grand succès aux États-Unis. La cause en est clairement qu’il s’agit d’un versant de l’histoire, le nom de l’auteur n’ayant aucune résonance particulière aux États-Unis. L’arrière-plan, l’histoire du manuscrit – the backstory, comme nous disons – a joué un rôle central dans le succès du livre : il était impossible de les séparer l’un de l’autre.
Je voudrais enfin vous parler de ma propre expérience de la traduction. J’ai en effet acquis, en tant qu’éditeur, les droits d’un roman paru chez Gallimard, La Théorie des nuages de Stéphane Audeguy, et décidé de le traduire moi-même bien que l’une et l’autre fonction soient normalement, et pour de très bonnes raisons, séparées. Je l’ai fait en partie par vanité, pensant que je pouvais faire du bon travail puisque, je l’avais établi, ce roman était par essence anglais. Il raconte notamment l’histoire d’un anglais obsessionnel qui fait le tour du monde pour photographier les nuages et se perdre lui-même en chemin. Des échos de Joseph Conrad et de Robert Louis Stevenson, avec, si l’on veut, une couche de marquis de Sade, m’ont convaincu que je comprenais la tradition à laquelle le livre se référait. Je comprenais le cadre. Bref, j’étais un Américain traduisant un roman français peuplé de personnages essentiellement – mais pas seulement – anglais. Une grande partie de l’histoire se déroule dans Hampstead Heath¸ à Londres, où l’observation des nuages est particulièrement fructueuse. J’y ai passé de nombreuses heures car je souhaitais savoir que quoi il s’agissait.
Le roman s’est assez bien vendu et a reçu quelques critiques flatteuses, ce qui m’a réjoui pour Stéphane Audeguy. J’avais rêvé qu’il devienne un best-seller mais ce ne fut pas le cas. Je me demande si le défi géographique n’était pas écrasant.
Jean-Guy Boin
Ana Estevan est éditrice chez Tusquets, une maison d’édition particulièrement francophile qui a publié Duras, Simenon et beaucoup d’autres. Elle rappelle qu’il existe des langues espagnoles et non la langue espagnole. Au-delà de la question du centre et de la périphérie se pose le problème de l’adaptation.
Ana Estevan
Je suis chargée de la coordination de l’ensemble des traductions pour Tusquets et ses filiales en Amérique latine. Crée en 1969, Tusquets est une maison d’édition de taille moyenne dont la moitié des livres sont traduits. Notre directrice, Beatriz de Moura, est également traductrice de Marguerite Duras et des ouvrages de Milan Kundera écrits en français. Entre autres auteurs, nous avons traduit Boris Vian, Erik Orsenna, Andreï Makine, Sade, Georges Bataille et Georges Simenon. Nous publions aussi des écrivains qui ont écrit concurremment dans deux langues, comme Jorge Semprún, Emil Cioran et Samuel Beckett. Cela nous a amenés à soumettre parfois notre traduction aux auteurs, notamment à Jorge Semprún, et un travail très créateur s’est engagé entre le traducteur et l’auteur.
Tusquets possède également filiales au Mexique, en Argentine et à Miami qui lui permettent de suivre de près ce qui se passe en Amérique. Ces filiales sont des maisons d’édition presque indépendantes, possédant leurs propres auteurs en langue espagnole, mais toutes les traductions sont faites en Espagne.
Éditer c’est choisir : choisir les livres et choisir les traducteurs. Et chez Tusquets, la relation au traducteur est envisagée, pour ainsi dire, comme un mariage. Nous avons une passion pour les bons traducteurs et, lorsque l’amour dure, c’est formidable ! S’il y a parfois des divorces, nous n’en continuons pas moins à vouloir les meilleurs traducteurs pour nos livres. Nous nous efforçons de les soigner et de les payer le mieux possible. En général, nous devenons bons amis.
Les livres traduits du français représentent en Espagne 2,9 % du total en 2000 et 2,4 % en 2010, et le français est la deuxième langue traduite en Espagne. Il faut dire que 22,1% des titres publiés en Espagne en 2010 sont traduits. Le flux principal vient de l’anglais, suivi par les langues européennes – avec un accroissement du suédois et des autres langues nordiques – et par les langues asiatiques. Cela étant, les traductions entre les quatre langues espagnoles – catalan, galicien, basque et castillan – augmentent depuis dix ans et représentent d’ores et déjà 19 % des flux. Dans le cas de Tusquets, nous avons commencé à publier des livres en catalan, mais aussi des traductions de langues étrangères au catalan. Cette importance des traductions en Espagne choque à cause de deux faits: la précarité de la collectivité des traducteurs en Espagne et la faible quantité de traductions de titres espagnols traduits en d’autres langues.
Mais malgré la légère diminution des traductions en Espagne les dernières années, et malgré l’hégémonie anglaise, l’émergence de nouvelles langues de traduction et aussi le flux de traductions parmi les langues espagnoles, le français reste comme la seconde langue étrangère traduite en Espagne.
Quant au flux des livres traduits, il y a quatre moyens de diffuser une traduction dans toute l’aire hispanophone (Espagne et Amérique latine): a) une maison d’édition espagnole achète les droits pour l’aire hispanophone, traduit et publie les livres en Espagne, puis les exporte ; b) une maison espagnole qui a acheté ces droits publie en Espagne mais aussi imprime et adapte les traductions par le biais de ses filiales, ce qui permet d’assurer un suivi de la qualité et de la distribution au continent américain. C’est le cas de Tusquets. Notre filiale argentine, la plus ancienne, est aussi le distributeur des livres ; c) une maison d’édition latino-américaine achète les droits seulement pour son pays, ou d) une maison d’édition latino-américaine achète les droits pour toute l’aire hispanophone, y-compris l’Espagne.
En général, les livres traduits en Espagne et distribués en Amérique Latine ont un bon accueil ; il faut prêter une attention spéciale aux expressions et aux mots délicats ou qui ont un autre sens dans les autres pays de langue espagnole. Et, en fin, les Académies de la langue de tout le monde hispanophone ont créé un Dictionnaire panhispanique pour donner une certaine unité à l’espagnol.
Jean-Guy Boin
Lorsque l’on parle de l’Amérique latine, on évoque en général des maisons situées en Argentine et au Mexique.
Ana Estevan
L’édition en Amérique latine est relativement faible et le réseau de distribution est peu développé. Quatre pays se détachent néanmoins : l’Argentine et le Mexique, comme vous l’avez indiqué, ainsi que la Colombie et, désormais, le Pérou. Un autre signe encourageant est que des petites maisons d’édition commencent à se créer.
Jean-Guy Boin
Nicolas Idier est depuis un an attaché culturel à l’ambassade de France à Pékin, chargé notamment de l’édition. Il va nous exposer le contexte de la traduction du français vers le chinois, sachant que l’organisation de la chaîne du livre en Chine est quelque peu spécifique par rapport aux deux exemples que nous venons d’aborder. L’édition d’État occupe une part très significative, même si l’on assiste à certaines évolutions étonnantes, très « dialectiques » en un sens et comportant une dimension géographique – entre Pékin et Shanghai ainsi que d’autres régions. Il parlera également du manque de traducteurs et des problèmes de formation. Le français est la troisième langue traduite en Chine.
Nicolas Idier
Lors de la table ronde suivante, consacrée aux logiques d’influence, vous entendrez Paul de Sinety, directeur du département Livre et Promotion des savoirs de l’Institut français, avec qui je suis en contact quotidien. Je limiterai donc mon propos à la géographie, non sans avoir remarqué que, dans l’enseignement français, on associe cette discipline à l’histoire. Lorsque l’on considère la géographie de la traduction en Chine, on s’aperçoit qu’elle reflète des rapports de force géopolitiques généralement anciens, conformément à l’analyse que vient de faire Gisèle Sapiro.
La France est en troisième ou quatrième position – selon que l’on rassemble ou non les États-Unis et la Grande-Bretagne – en termes de volume de cession de droits. Depuis que la Chine s’est ouverte à nouveau, à la fin des années 1970, elle occupe une position de choix. Elle est cependant très largement distancée par les États-Unis – ce qui vient relativiser l’anti-américanisme que l’on prête généralement aux Chinois – et la Grande-Bretagne.
Le tableau des quinze premiers pays pour ce qui est des cessions de droits en Chine est également un panorama de l’histoire de ce pays : depuis le XIXe siècle, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France jouent un rôle géopolitique considérable pour la Chine, le cas de la France étant spécifique puisqu’il nous fait remonter au XVIIIe siècle. Viennent ensuite la Russie puis les pays asiatiques. En effet, la géographie de la traduction dans l’aire chinoise correspond au monde chinois. La culture issue de l’écriture chinoise ne s’arrête pas aux frontières historiques de la Chine : le Japon, la Corée, l’Asie du Sud-Est jusqu’à la latinisation des alphabets au XIXe siècle, font partie de ce que Jacques Gernet appelle « le monde chinois ».
Il est à noter que l’Espagne n’est pas dans les quinze premiers pays.
Dans cette sorte d’organisme que constitue le monde chinois, il existe des disparités considérables. Gisèle Sapiro a ainsi indiqué que 65 % des livres publiés en Corée sont des traductions. En Chine, c’est bien entendu tout différent et ceux qui travaillent à la cession de droits le savent bien.
Hier, la deuxième table ronde de l’après-midi était consacrée à la formation des traducteurs. La question est à mon sens centrale pour ce qui est des traductions français-chinois et chinois-français. Malgré les manques considérables que pointent les éditeurs contemporains, l’intérêt de la France pour la Chine remonte au XVIIIe siècle, et même au XVIIe, lorsque les Jésuites se sont employés à traduire la pensée philosophique chinoise fondamentale. Du reste, le grand dictionnaire chinois-français, le Dictionnaire Ricci – du nom de Matteo Ricci, un des premiers membre de la Compagnie à avoir pénétré en Chine à la fin du XVIe siècle –, est l’œuvre des Jésuites.
Cet intérêt ne s’est jamais démenti. Parmi les maisons d’édition publiant de la littérature chinoise, on peut citer Gallimard, avec la collection fondée par Étiemble et aujourd'hui la collection « Bleu de Chine », Actes Sud, mais aussi Les Belles Lettres, avec une des plus belles entreprises de traduction existant à l’heure actuelle, « La Bibliothèque chinoise », lancée par Anne Cheng et Marc Kalinowski, qui propose les textes dans une version bilingue à l’instar de ce qui existait pour le grec et le latin.
Par comparaison, l’intérêt pour la France en Chine semble modeste. Même si la France occupe une place importante pour ce qui est des traductions – pour des raisons essentiellement historiques et politiques –, la situation exige que l’on reste mobilisé. La littérature contemporaine française a du mal à s’imposer face aux best-sellers mondiaux. Du reste, « best-seller » est le premier mot qu’un éditeur chinois prononcera lorsqu’on essaiera de lui parler d’un titre. Le constat est le même pour les sciences humaines et sociales, où il faut remonter à trente ans pour pouvoir parler de best-seller : la diffusion est réduite au monde universitaire.
Depuis 2005 ou 2006, Pékin est un « pôle régional de traduction » au sein du grand « Plan Traduire », que l’Institut français s’emploiera à compléter en y ajoutant un « Plan Traduire numérique ». La formation des traducteurs, évoquée notamment par Jörn Cambreleng, est une priorité.
Vient ensuite la question des partenaires. Jean-Guy Boin, très bon connaisseur de la Chine et qui se trouvait encore à Pékin pour le salon du livre au début de septembre, sait bien que la géographie de la traduction dans ce pays est très centralisatrice, même si d’autres villes ont des velléités pour s’imposer. L’édition est présente à Shangai, dans le Hunan, dans le Jiangxi, etc., mais les bureaux de représentation se trouvent en général à Pékin. L’édition est avant tout une question de pouvoir en Chine et la proximité avec le pouvoir est obligatoire.
La grande difficulté pour trouver des partenaires tient au contexte politico-institutionnel : la Chine reste marquée par un système autoritaire et le pouvoir impose son influence en premier lieu dans le domaine culturel. Même si les flux économiques créent des opportunités, le politique reste dominant. Nos avons des interlocuteurs politiques. Toute maison d’édition qui rachète les droits d’un livre doit tenir compte, à un moment ou un autre, de cette dimension.
Cela dit, les rapports entretenus avec les partenaires institutionnels ne sont pas forcément mauvais. Si, au cours de la journée d’hier, on a pu regretter parfois des liens trop forts entre l’université et le monde de la traduction, force est de constater que c’est une bonne chose en Chine, où les traducteurs sont souvent des universitaires. L’université étant également le lieu où l’on apprend à connaître le contexte – le préalable au texte –, leurs traductions échappent à la superficialité.
Le français n’est pas une langue difficile à maîtriser pour les Chinois. En revanche, le contexte l’est, de même que l’intertextualité. La traductrice, très compétente, de La Guerre du goût de Philippe Sollers me disait récemment combien elle était effrayée par le nombre de références qui truffent ce texte. Autre exemple, le petit essai Pourquoi lire ? de Charles Dantzig, ouvrage dont un Français ne se rend même pas compte de la densité : les traducteurs chinois ont été confrontés à d’immenses problèmes de références. De ce point de vue, le monde universitaire est important pour la traduction.
Les éditeurs sont également des partenaires institutionnels, même si l’économie a réussi parfois à creuser une certaine originalité. On a ainsi vu éclore depuis quelques années des maisons d’édition privée, dénommées « ateliers de création ». Mais l’ISBN, obligatoire pour toute publication, reste détenu par les maisons officielles, directement liées au pouvoir politique – en l’occurrence le GAPP, ou Administration générale de la presse et de l'édition.
En Chine, on a tendance à dire – du moins pour ceux qui ne se trouvent pas au cœur du pouvoir politique – que la question est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin. Les éditeurs le savent bien, et ils en jouent. Pour les trois livres de Michel Houellebecq publiés en chinois, on a assisté à un jeu du chat et de la souris entre le « très officiel » et le « moins officiel », destiné à déjouer un peu la stratégie de la censure.
Car la censure est bien là et empêche la publication de très nombreux textes. Les livres d’histoire et ceux qui parlent de la Chine sont analysés de particulièrement près. Les Chinois restent globalement ignorants de leur histoire récente et de la révolution culturelle, par exemple. Une grande partie de la littérature publiée à Taïwan est censurée. À Hong Kong, on est émerveillé par le nombre de biographies politiques, totalement absentes des rayonnages dans le reste de la Chine.
Cependant, la multiplication des éditeurs permet de desserrer cette censure. En 2010, on comptait 580 éditeurs en Chine, publiant un total de 250 000 livres par an. Si l’on y ajoute la production numérique, on voit bien qu’il devient très difficile de tout censurer. Dans ce jeu permanent avec la limite, il se crée une liberté éditoriale où la traduction peut se développer.
Après une année 2008 à la baisse en raison d’un mauvais contexte politique, les droits de 13 000 titres étrangers ont été cédés en 2010, dont 700 titres français. De même qu’en France on assiste à des phases de sinophilie et des phases de sinophobie, la Chine est sujette à des oscillations. En ce moment, on assiste à un certain repli culturaliste. Les instituts Confucius tentent de reconstruire une tradition à laquelle les Chinois s’intéressent de plus en plus, même si elle est souvent fabriquée de toutes pièces. Les émissions littéraires vedettes à la télévision parlent de Confucius, de la grande tradition chinoise, de l’empire. Du matin au soir, des téléfilms remettent en scène l’histoire impériale. Ce mouvement se traduit par un léger désintérêt pour les traductions étrangères, y compris françaises.
Pour autant, nous ne devons pas baisser les armes. Parmi les programmes d’aide à la publication que l’Institut français développe de par le monde, le nôtre porte le nom du traducteur de Balzac, Fu Lei – le statut du traducteur en Chine aussi pitoyable sur le plan économique qu’il est considérable sur le plan moral. Notre action passe aussi par la programmation culturelle : nous invitons des intellectuels et des écrivains, nous organisons des événements destinés à montrer, à l’échelle médiatique, l’actualité tant en matière de fiction que de non-fiction et à promouvoir la traduction.
La question de la traduction est aussi celle de la qualité des livres sources. Or, souvent, les éditeurs et les amateurs de culture française déplorent la médiocrité de la production éditoriale française. Un bon livre trouvera toujours un traducteur et une bonne traduction d’un bon livre trouvera toujours son public, dans quelque domaine que ce soit. Il est réconfortant, somme toute, de voir que tout n’est pas affaire d’économie ou de diplomatie culturelle, mais simplement de qualité littéraire.
Jean-Guy Boin
Je précise que les chiffres que j’ai communiqués concernent les cessions de droits de livres qui ne sont pas dans le domaine public. Il faut effectivement mentionner le nombre considérable de traductions de titres libres de droits que proposent les librairies chinoises.
J’ajoute que les join-ventures passés entre des éditeurs de Taïwan et des éditeurs de Chine continentale peuvent être porteurs d’avenir.
Je donne maintenant la parole à Richard Jacquemond, professeur de langue et de littérature arabe moderne à l’université d’Aix-Marseille, qui a longtemps séjourné en Égypte où il a notamment dirigé le département de traduction au sein de la mission culturelle française. Son intervention portera sur le contexte de l’édition dans le monde arabe. Selon un vieux proverbe, l’Égyptien écrit, le Libanais imprime et l’Irakien lit...
Qu’en est-il, par ailleurs, du phénomène du piratage dans le monde arabe et, s’agissant de la traduction, de l’influence française dans les pays optiquement francophiles – ceux du Maghreb – et dans ceux qui subissent une influence anglophone, en particulier les pays du Golfe ? J’ai constaté récemment à Abou Dabi que les choses étaient moins tranchées qu’auparavant entre francophilie et anglophilie.
Richard Jacquemond
L’aire linguistique, culturelle et politique arabe représente plus de vingt pays et 300 millions d’habitants et lecteurs potentiels.
Je suis moi-même arabisant. J’ai commencé à traduire au moment où j’apprenais l’arabe puis, pendant sept ans, j’ai été chargé au sein du service culturel de l’ambassade de France en Égypte de mettre en place une politique de traduction du français vers l’arabe, mais aussi de l’arabe vers le français. Par la suite, comme chercheur et comme traducteur, j’ai continué à investir ces questions sur lesquelles, aujourd'hui, je pose plutôt un regard de sociologue, à la façon de Gisèle Sapiro.
Dans le contexte des années 2000 – des attentats du 11 septembre et des rapports du programme des Nations unies sur le développement jusqu’au printemps arabe – la représentation dominante du monde arabe à l’extérieur était celle d’une culture fermée sur elle-même, un des indices de cette fermeture étant la faiblesse du marché du livre et du nombre de traductions. Pourtant, la situation de l’édition et de la traduction ne correspondait pas à cette description : un changement sensible se produisait dans la diffusion du livre, dans le nombre de traductions et dans le lectorat. C’est un des éléments qui, a posteriori, annoncent le printemps arabe, même si personne ne peut prétendre avoir prévu ces événements : la production et la consommation du livre, en particulier du livre traduit, reflétaient la montée de la classe moyenne éduquée dont on sait quel rôle elle a joué par la suite.
Comme l’a indiqué Jean-Guy Boin, les cessions de droits sont passées de 42 à 155 entre 2000 et 2010 dans le monde arabe, soit presque une multiplication par quatre même si les chiffres restent modestes. L’insertion de l’édition arabe dans le marché mondial a donc progressé, de même que le recours à la cession de droits : quand je suis arrivé en poste en Égypte, en 1988, presque tous les livres traduits étaient piratés.
Mais les progrès restent fragiles. Le marché est très fragmenté et, de ce point de vue, la situation est plus difficile aujourd'hui. Des années 1950 aux années 1970, les deux grands centres de production éditoriale diffusant dans l’ensemble du monde arabe étaient Beyrouth et Le Caire. À mesure que les États se sont développés, nous avons maintenant vingt marchés nationaux du livre, avec toutes les difficultés que cela représente en termes de circulation : le marché arabophone est beaucoup moins unifié que les marchés anglophone, hispanophone ou francophone.
L’édition du monde arabe est dans une situation générale de sous-développement. Elle est peu professionnalisée et dispersée entre très petits éditeurs. Les éditeurs les plus importants sont des entreprises familiales. Le marché des traducteurs est lui-même très éclaté. Les traducteurs professionnels sont peu nombreux mais il y a des milliers de traducteurs occasionnels ou amateurs, le phénomène étant accentué par la multiplication des programmes publics ou parapublics d’aide à la traduction, qui offrent souvent des rémunérations plus satisfaisantes que l’édition privée. Un effet d’aubaine pousse certains traducteurs à s’investir pour des raisons financières, sans qu’ils aient forcément les compétences requises.
Les chiffres ne sont pas très éloignés de ceux de la Chine – les livres traduits en arabe représentent 5 à 10 % du marché – et révèlent également une tendance à la professionnalisation de l’édition, une ouverture sur le monde et une entrée dans le marché mondial de l’édition.
Un autre aspect de la traduction, très important pour l’arabe, est celui de la part qu’elle prend dans la transformation de la langue. Ce phénomène historique a été évoqué ce matin pour les langues nationales européennes au XIXe siècle. La langue arabe, quant à elle, continue d’être massivement formée et transformée par les traductions, si bien, que comme en Chine, le statut moral du traducteur fait l’objet d’une reconnaissance particulière. En littérature et en sciences humaines, il est de tradition que son nom figure sur la couverture du livre. Le statut matériel pose d’autres problèmes...
Pour ce qui est de la langue française, l’écart est très important entre le Maghreb, où la majorité des livres traduits le sont du français, et le Mashrek, le Moyen-Orient, où l’anglais est dominant. En Égypte, 75 à 80 % des traductions viennent de l’anglais, environ 10 % du français et le reste des autres langues. Dans deux pays cependant, le Liban et la Syrie, le français fait presque jeu égal, pour des raisons historiques, avec l’anglais.
La demande de traduction du français est dominée par le retour en arabe soit de livres écrits par des auteurs arabes d’expression française, soit de livres ayant le monde arabe pour objet. Une autre tendance forte, en matière de sciences humaines et sociales, est la traduction de littérature « de seconde main » – manuels universitaires, « Que sais-je ? », etc. –, tandis que la traduction des ouvrages de fond est souvent plus tardive et sujette à des effets de mode importants.
Jean-Guy Boin
Je propose que nous en venions directement aux questions de l’assistance.
Françoise Wuilmart
Vous avez insisté, monsieur Idier, sur la capacité des universitaires à saisir les références culturelles. Selon vous, le mariage entre université et traduction littéraire est nécessaire. Est-ce à dire que le traducteur est l’idiot de la famille, qui s’occupe des mots et pas des choses ? Dans notre esprit et dans la formation idéale que nous envisageons, le traducteur professionnel est aussi cultivé, et pas plus idiot, que les universitaires. Un de nos plus grands traducteurs, Bernard Hoeppfner, a beau être un autodidacte, aucune allusion culturelle ne lui échappe ! J’ai moi-même traduit de nombreux livres de philosophie. Le travail considérable que cela a représenté m’a évité, je l’espère, de passer à côté des allusions qu’ils recèlent.
Nicolas Idier
Mon propos concernait essentiellement la Chine. Il ne s’agissait nullement de décrire un contexte global. On peut toujours souhaiter autre chose, mais il se trouve qu’en Chine beaucoup de traducteurs sont des universitaires. Il serait formidable que la formation que vous avez décrite hier soit proposée en Chine. Nous organisons pour notre part des formations de traducteurs depuis six ans. Cela dit, les éditeurs rémunèrent très peu les traducteurs et il faut bien que ces derniers vivent. L’édition chinoise connaît une mutation progressive et n’est pas encore très rentable. Le prix du livre correspondant à environ 2 euros, la chaîne du livre n’est pas du tout rémunératrice. Loin de moi l’idée que le traducteur serait l’idiot de la famille ! La question est très pragmatique : il faut bien manger. C’est ce qui fait que beaucoup de traducteurs sont des universitaires.
Jean-Guy Boin
Jean-Luc Domenach, qui a été en poste à l’université de Pékin pendant plusieurs années, remarquait que beaucoup d’universitaires étaient amenés à jouer le rôle d’editors en proposant les textes, traduits par leurs soins, aux éditeurs chinois. C’est un trait propre à la Chine.
Françoise Wuilmart
Je connais plusieurs traducteurs chinois, dont Wan Bingdong, qui a traduit tous les albums de Tintin et qui a participé aux sessions du Collège européen de traduction littéraire que je dirige. C’est un universitaire et son français est époustouflant.
Ma deuxième question s’adresse à Mme Estevan. Vous affirmez ne recruter que les meilleurs traducteurs. Quels sont vos critères ? Le bouche-à-oreille, les diplômes ? J’imagine que vous ne recrutez pas de débutants...
Ana Estevan
Un curriculum ne m’intéresse pas : ce n’est pas une traduction. Je préfère faire une preuve de traduction de quelques pages. Le bouche-à-oreille entre traducteurs et entre éditeurs a son utilité, car il est parfois difficile de déterminer si la qualité de la traduction est le fait du traducteur ou des corrections apportées par l’éditeur.
Quant aux débutants, notre meilleure traductrice du japonais, Lourdes Porta, est une Espagnole qui a commencé à traduire en association avec un professeur japonais en poste à Barcelone. Pour les nouveaux traducteurs, l’éditeur exerce un rôle d’enseignement – du moins dans notre conception artisanale, car je doute qu’on le fasse ailleurs. Il faut apporter une certaine aide à ceux qui débutent.
Françoise Pertat
M. Idier indique que le livre revient à deux euros en Chine. C’est considérable par rapport au salaire moyen.
Nicolas Idier
D’après les statistiques, près de la moitié des foyers chinois n’ont pas un seul livre. D’ailleurs, depuis la réouverture de la Chine et sa relative libéralisation, les librairies sont devenues des sortes de bibliothèques municipales sauvages. Beaucoup de gens n’y vont que pour lire, notamment dans les rayons de traduction, mais peu passeront à la caisse.
Françoise Pertat
Quels sont les romans français qui ont du succès en Chine ?
Nicolas Idier
Les classiques continuent de rencontrer un large public. Parmi les auteurs plus contemporains, Françoise Sagan est très lue, et parmi les auteurs actifs, Jean-Marie Le Clézio connaît un grand succès, pas seulement grâce à son prix Nobel mais parce qu’il s’adresse à une humanité essentielle que perçoit le lecteur chinois. Les Chinois aiment aussi Patrick Modiano : Dans le café de la jeunesse perdue, lauréat du Prix Fu Lei de la traduction 2011, fait partie des cent livres traduits qui se vendent le mieux.
Il faut également mentionner le succès de Jean Echenoz, dû à Chen Tong, un éditeur de Canton – cette ville, peut-être à cause de son éloignement de Pékin, a une tradition de liberté impressionnante – qui est tombé fou amoureux des éditions de Minuit depuis près de trente ans et qui publie nombre des textes de cette maison. Alain Robbe-Grillet, sur son lit de mort, lui a offert ses lunettes, par une sorte de transfert symbolique.
Jean-Guy Boin
Non seulement Chen Tong publie ces textes, mais il les vend.
Nicolas Idier
Difficilement, et grâce à une librairie qu’il a lui-même fondée. Les intellectuels, les auteurs, les traducteurs, les libraires et les éditeurs chinois « savent y faire » pour que leurs livres existent.
Françoise Pertat
Il a été dit également que les traductions se vendent en grand nombre en Corée. Comment expliquer ce degré d’ouverture ?
Anne-Solange Noble
Depuis une vingtaine d’années, nous cédons beaucoup de droits en Corée du Sud. C’est une des langues où nos livres sont le plus traduits.
Jean-Guy Boin
Après la guerre de Corée, ce pays a connu un régime autoritaire, mais sans qu’il existe une diaspora importante. Quand il s’est ouvert, il s’est lancé dans une quête d’ouverture sur le monde. La Corée traduit donc beaucoup du français – environ 800 titres par an –, beaucoup d’autres langues aussi. La francophilie y est assez forte. Pour des raisons historiques, elle a des relations complexes avec l’île qui se trouve en face d’elle... J’observe également que beaucoup de livres allemands sont traduits en coréen.
Richard Jacquemond
C’est aussi, pour une bonne part, un effet du niveau de développement de l’édition locale. Lorsque, comme en Europe de l’Ouest, la population est alphabétisée à 99 ou 100 % et qu’il existe un lectorat important et un système d’édition professionnalisé, le nombre de traductions s’accroît fortement. En effet, un livre traduit coûte plus cher à produire qu’un livre en langue originale. On pourrait sans doute établir un rapport de proportionnalité entre l’importance du nombre de traductions et le degré de développement du secteur national de l’édition. Dans le monde arabe, le phénomène est très net.
Une intervenante dans la salle
Lorsque l’on réfléchit à logique interne de la traduction, on peut se demander si la traduction à outrance – entre le castillan et le catalan, par exemple – ne fait pas courir le danger, à long terme, de voir disparaître progressivement le bilinguisme et le multilinguisme. Il n’y a pas si longtemps, Danois, Norvégiens et Suédois lisaient directement dans les langues de leurs voisins. On ne traduisait pas : les livres étaient disponibles. La situation a maintenant changé. Un Suédois, maintenant, ne lirait plus un livre directement en danois, non pour des raisons linguistiques mais pour des raisons culturelles et parce que la traduction s’est installée entre les deux langues.
Or la disparition du bilinguisme et du multilinguisme constitue un appauvrissement. Nous avons tendance à oublier que la plupart des gens vivent dans un monolinguisme quasi complet et que cela peut devenir dangereux. En France, tous les films qui passent à la télévision sont doublés. On n’a pas accès aux langues, on ne les entend plus et on finit par ne plus s’y intéresser. Cela a une répercussion sur l’apprentissage. La logique selon laquelle il faut traduire tout ce qui peut être traduit, c’est un peu le serpent qui se mord la queue.
Ana Estevan
Je peut dire que les traductions « internes » sont très subventionnées par les gouvernements des communautés galicienne, catalane et basque. Aussi, il existe une vraie collaboration entre les éditeurs pour permettre la publication simultanée de livres traduits, par exemple, de l’anglais ou le français, dans les quatre langues espagnoles.
Françoise Wuilmart
La traduction-relais – la traduction faite à partir d’une autre traduction – est une des plaies de la traduction littéraire. Le problème est particulièrement aigu dans les pays arabes, où l’on a beaucoup traduit de grands classiques à partir de l’anglais ou du français. Depuis le printemps arabe, envisage-t-on d’infléchir la situation en introduisant enfin l’enseignement d’autres langues, qui permettra la traduction directe des grands classiques, ou reste-t-on sur un statu quo ?
Richard Jacquemond
Le problème, on l’a dit ce matin, n’est pas spécifique à l’arabe, qui est en l’occurrence dans la même situation qu’une petite langue européenne par rapport à une autre petite langue européenne. La traduction d’auteurs arabes en estonien, en hongrois, en polonais, en tchèque, etc., se fera également de façon indirecte. Le problème est celui des rapports des langues dites périphériques entre elles.
Françoise Wuilmart
N’est-il pas plus concentré dans le monde arabe ?
Richard Jacquemond
Pas du tout. La situation a plutôt tendance à s’améliorer grâce à des programmes qui font prévaloir de bonnes pratiques de traduction. Dans certaines formes d’édition, on évite de passer par la traduction indirecte.
En outre, les traducteurs arabes ne sont pas seulement anglophones ou francophones. Il y a depuis longtemps de très bons traducteurs de l’italien, du russe, de l’allemande, de l’espagnol... Le problème se pose plus pour les langues vraiment périphériques.
Nicolas Idier
En Chine, le risque serait que le français cesse, à terme, d’être une langue relais. Lors d’un colloque international, mon collègue polonais et moi-même nous sommes entendu dire par le président de séance que nous représentions deux petites langues...
Jean-Guy Boin
En conclusion, je demanderai à Timothy Bent, qui vient d’un pays à la fois lointain et proche, les commentaires que lui inspirent ces échanges.
Timothy Bent
Ce que je constate, c’est que les Français adorent les chiffres !
Je souscris à l’analyse qu’Esther Allen a faite hier matin de la traduction aux États-Unis. À côté de l’isolationnisme, il y a aussi la richesse de la littérature en langue anglaise : nous pouvons lire des romans indiens, irlandais, sud-africains... Le français est confronté à cette richesse, et à l’empire britannique à la solde duquel je travaille. Pour des livres français, allemand ou espagnol, il est difficile de pénétrer le marché américain. Le français est néanmoins la langue la plus traduite aux États-Unis, et j’en suis fier !
Dans le domaine de la non-fiction, le statut académique est prépondérant. À titre d’exemple, j’ai acheté hier les droits d’un livre sur la chute de Napoléon. Cet épisode a certainement fait l’objet de milliers d’ouvrages écrits en français mais l’auteur, un historien de l’université de Londres, connaît parfaitement le sujet.
Gisèle Sapiro soulignait à juste titre que les presses universitaires des États-Unis sont très dynamiques dans le domaine de la traduction. Dans les années 1980, l’université du Minnesota a publié des dizaines d’ouvrages de Derrida, de Barthes, de Foucault, introduisant la philosophie française contemporaine aux États-Unis. Aujourd'hui, malgré quelques échos, la domination française n’existe plus.
Françoise Pertat
Comment l’expliquez-vous ?
Timothy Bent
C’est trop compliqué !
Jean-Guy Boin
Ce n’est pas uniquement lié, je crois, à une éventuelle posture idéologique ou géopolitique des éditeurs américains. Il faut convenir que la production française de sciences humaines des années 1990 et 2000 n’est pas du même ordre que celle des années 1970 et 1980. La nature de l’offre étant différente, la nature de réception l’est aussi.
Gisèle Sapiro
Pourtant, les sciences humaines continuent à se vendre plutôt bien aux États-Unis, et même mieux que la littérature.
Timothy Bent
Pour prendre l’exemple de l’histoire, il existe une grande différence entre la France et le monde anglo-saxon. Les historiens anglais et américains font du récit.
Jean-Guy Boin
Je remercie tous les participants.